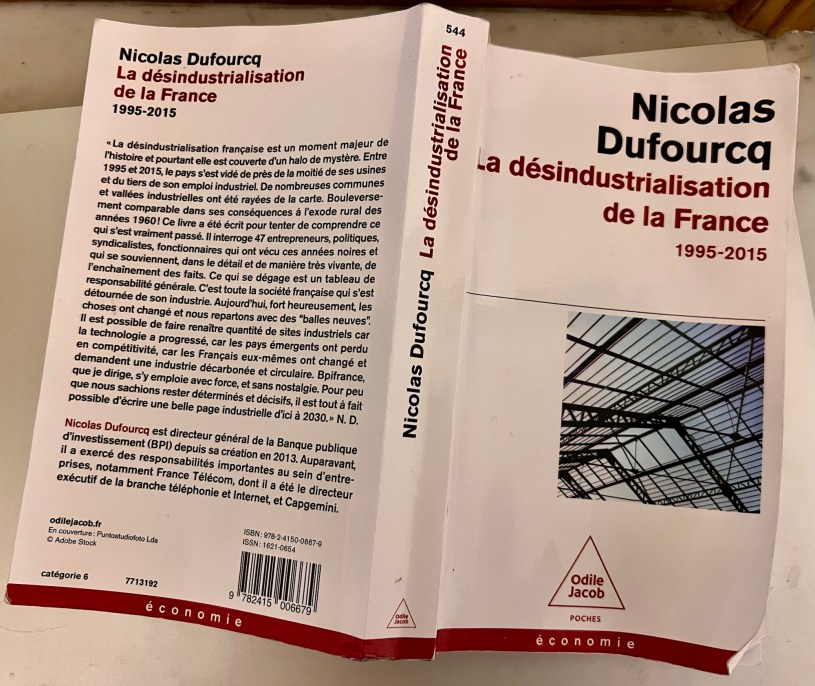Le dirigeant de la Banque Publique d’Investissement, Nicolas Dufourcq, s’intéresse en particulier depuis 2020 à la réindustrialisation du pays. À cette occasion, il partage dans l’introduction de son livre avoir dû se rendre à une évidence : il n’y a pas d’évidence. C’est-à-dire qu’alors qu’il tentait de poser un diagnostic pour les actions futures de bpifrance, il s’est trouvé dans la plus grande difficulité à définir clairement les causes racines du problème à résoudre.
Chacun s’est forgé son idée sur le sujet, les convictions sont multiples, les situations se révèlent complexes et les débats tournent vite au partisanisme voire à l’idéologie. L’auteur s’est donc résolu à publier en 2021 un ouvrage choral qui donne la parole à une cinquantaine de dirigeants de l’époque afin qu’ils expliquent ce qui – selon eux – s’est passé.
L’ouvrage fait partie de ces livres qu’il faut lire. Parce que c’est un document historique qui reflète son époque ; et parce qu’en le parcourant un stylo à la main, on comprend ce qui s’est passé. Quand on fait le tri entre les variétés de lieux, de secteurs et de situations ; quand on fait la part des opinions personnelles et des faits ; quand on relie le dit et le non dit et qu’on lit entre les lignes… on comprend.
Alors, que comprend-on ? Lisez l’ouvrage pour tirer vos conclusions ! Et si jamais vous souhaitez une version courte, je vous propose ici une syntyèse très personnelle des cinquante témoignagnes. Je l’ai écrite pour moi. Pour fixer mes idées et pour ne pas oublier. Je la partage à toute fin utile, mais gardez en tête qu’elle n’engage que moi ; voire même pas moi.
Un mot d’abord sur la méthodologie
L’ouvrage est remarquable. On ne remerciera jamais assez Nicolas Dufourcq d’avoir mené à bien ce projet et d’avoir rassemblé cinquante témoignages d’une qualité aussi haute sur le sujet. Notons que le recueil comprend 5 témoignages d’hommes politiques, 28 témoignages d’industriels représentant 10 secteurs (aéronautique, agroalimentaire, automobile, bois et bâtiment, câblerie et optique, électronique et électroménager, ingéniérie, machine-outil et textile, mécanique, plasturgie), 2 témoignages de syndicalistes, 3 témoignages de banquiers, 6 téloignages d’économistes et 2 témoignages de fonctionnaires. En plus de l’introduction par Nicolas Dufourcq et l’épilogue par Louis Gallois.
La méthode – comme toute méthode – a ses limites. Par exemple il s’agit uniquement d’hommes, presque tous blancs et tous assez âgés, voire très âgés. C’est la résultante d’un choix : l’auteur a interrogé des personnes qui avaient le pouvoir entre 1995 et 2015. L’industrie est un milieu masculin et si vous vous trouviez aux commandes en 1995, vous n’êtes plus tout jeune en 2021. Beaucoup des personnes interrogées ont un lien avec bpifrance. Nicolas Dufourcq a donc apparemment surtout interrogé ses amis. On ne peut pas lui en vouloir et j’aurais probablement agi à l’identique à sa place. Cela introduit un biais, mais je ne pense pas que ce biais influe sur la synthèse à venir. Enfin, une majorité des textes semble la transcription écrite d’un entretien oral. Le style est trop homogène pour qu’il n’y ait pas une plume qui a retranscrit les propos d’une proportion significative des participants. J’aurais apprécié que l’auteur remercie cette plume quelque part. Si je veux bien croire qu’il a mené les entretiens, je l’imagine mal avoir tout recopié et reformulé lui-même. Il remercie son assistante Florence à la page des remerciements ; je prends le pari que le nom d’une plume a été occulté. Dommage.
Un détour par les faux nez
Certaines raisons avancées de la désindustrialisation de la France apparaissent au fil des pages comme fausses raisons. Non pas qu’elles n’aient pas joué du tout, mais plutôt qu’il s’agit d’éléments somme toute mineurs ou surmontables. Ce sont de faux nez ; des excuses de façade dont on peut se satisfaire dans un diner mondain, mais qui ne passent pas le filtre de l’analyse de fond.
Non, l’euro n’est pas le problème. Ce serait une approche quelque peu nombriliste des choses. On peut noter le même processus de désindustrialisation aux États-Unis et dans la plupart des pays développés. Certains économistes ont pu défendre l’idée que l’euro a avantagé l’Italie et l’Allemagne. La première parce qu’elle a dévalué la Lire une dernière fois fortement en 1993. La seconde parce que sa politique de réunification volontairiste avec l’Allemagne de l’Est lui a permis de profiter d’une zone à bas coût au sein de son pays. L’analyse n’est pas fausse, mais c’est donner beaucoup d’importance à la comparaison avec nos voisins directs alors que la compétition est globale. Et c’est donner beaucoup d’importance à un seul facteur eplicatif. Par ailleurs, de nombreuses voix s’élèvent dans l’ouvrage pour célébrer l’euro comme un facteur positif : libre échange, fin du casse-tête des taux de change, stabilité des monnaies… l’euro fut un facteur positif de développement. Et le taux de change au moment de la bascule n’est qu’un point de départ. Il n’explique pas tout. Le succès de l’Allemagne à l’époque tient plus à la “Deutsche Qualität” dont la réputation n’était pas infondée qu’à des prix bas. Penser que l’euro est responsable de la désindustrialisation de la France, c’est se raconter des carabistouilles.
Non, les 35 heures ne furent pas le problème. Certes, elles ont renchéri les coûts de production de 11% du jour au lendemain. Certes, elles furent vécu comme une punition. Certes, elles envoyèrent le message haut et fort que le temps libre est plus important que le travail. Certes, leur application a poussé à l’accélération du mouvement de désindustrialisation. Certes, elles ont contribué à l’image négative de l’industrie française à l’étranger. Bref, il apparait indéniable que cette mesure n’a pas aidé le tissu industriel du pays. Et plus d’un participant au livre les met en cause. Mais bien d’autres considèrent que cette réforme aurait pu être surmontée dans un contexte différent. Elle fut le produit de son époque ; le résultat d’une ambiance plutôt que sa cause. Derrière les 35 heures, il y a des tendances de fond.
Les tendances de fond
On note plusieurs grandes tendances qui marquent l’époque et apparaissent comme d’immenses lames de fond inarrêtables. Au-delà des histoires individuelles et des capacités de certains secteurs et individus à naviguer les courants et à tirer leur épingle du jeu, le vent souffle dans une certaine direction. Et on ne peut pas l’ignorer.
L’économie mondialisée permet l’émergence de la Chine et l’Europe de l’est. Le Maroc crée par décret la zone franche de Tanger en 1997. La Chine devient membre de l’Organisation Mondiale du Commerce depuis 2001. Dix pays d’Europe centrale entrent dans l’Unione européenne en 2004. Voici trois exemples d’une même réalité : nous avons collectivement au niveau du monde décidé et accepté le rééquilibrage de l’économie mondiale au travers du rattrapage plus ou moins organisé des pays développés par les pays émergents. Ce rattrapage est passé par le transfert d’activités industrielles vers ces zones aux salaires plus bas et aux normes sociales moins contraignantes. La désindustrialisation de la France est donc la résultante du succès de l’industrialisation de ces autres pays. On peut se demander qui était le “nous” dans l’affirmation “nous avons décidé au niveau du monde”. C’est un débat plus large qui dépasse le propos ici. Pour autant, voici une première grande tendance qui dépasse l’euro, les 35 heures et en fait toute tentative d’influencer le cours des choses à l’échelle de la France. À partir du moment où l’Asie du sud-est s’éveille, où l’on souhaite l’intégration réussie de dix économies pauvres à l’est de notre bloc géographique et où nos voisins directs – l’Afrique du nord dans l’exemple cité – souhaite se développer, quelqu’un doit leur faire une place. Ce quelqu’un, ce fut entre 1995 et 2015 le secteur industriel. Et pas seulement français. Des Américains feraient le même constat en remplaçant l’Afrique du Nord par le Mexique. Mêmes causes, mêmes conséquences.
L’usine ne fait pas rêver et sert de repoussoir au système éducatif. Lamode est au secteur des services, considéré plus noble et qui d’ailleurs paie mieux. L’imaginaire collectif est plus puissant qu’on ne le pense. Presque tous les textes du livre déplorent l’image de l’industrie à l’époque. Je ne peux que me faire écho de ce témoignage. Toute mon enfance, j’ai vu mon père diriger la verrerie familiale que nous avons vendue en 2007, l’année de ses cent ans. Cette très belle et très moderne fabrique a servi d’aiguillon éducatif à bien des voisins et des cousins. Chaque fois que le fils ou la fille d’amis de mes parents ont pensé arrêter jeune leurs études, mon père les a pris en stage. J’en connais qui n’ont tenu que deux jours ! Ils ont tous repris leurs études. L’anecdote peut faire sourire, mais elle représente bien un mal plus profond noté par bien des voix de l’ouvrage : l’univers industriel repousse et l’éducation nationale s’en détourne. Travailler à l’usine est vu comme un choix par défaut à éviter par tous les moyens possibles. On note une double responsabilité ici : d’abord les patrons pour ne pas avoir mené et gagné la bataille de l’image. Les grands industriels ont laissé “Zola” et “Les temps modernes” gagner face à une image futuriste et positive du métier de la fabrication et de la transformation. À tel point que je ne parviens pas en écrivant ces lignes à identifier une image à placer en contrepoint de “Zola” et “Les temps modernes”. Ensuite une responsabilité éducative. L’école française a fait l’apologie des études longues, du bac pour tous, découragé l’apprentissage, limité les filières manuelles, a nommé les diplômes tournés vers l’industrie “baccalauréat” professionnel ou technologique et en a fait de fait des sous-choix plutôt que des filières spécifiques et à part. On a construit un imaginaire collectif où travailler de ses mains se veut négatif par rapport à travailler de sa tête. On ne peut pas s’étonner qu’une idée répétée pendant des décennies finisse par prévaloir. Il suffit d’ouvrir les livres d’enfant de mes filles de 4 et 6 ans pour se rendre compte des soucis de représentation du monde industriel dans l’insconscient collectif.

U pour Usine dans l’abécédaire gigogne de Xavier Deneux, éditions Milan
L’absence de nouvelles créations d’usine. Ce qui peut frapper à la lecture des témoignages est l’absence de nouveau. Que des usines ferment parce que les dirigeants ont commis une erreur, que le marché a évolué, qu’une famille n’a pas trouvé de repreneur ou parce qu’un concurrent les a racheté et a pris une décision géographique… c’est la vie des affaires. Le facteur le plus fort dans de la désindustrialisation de la France se trouve peut-être en fait absent du récit, c’est l’absence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs qui prennent le risque de fonder de nouvelles entreprises industrielles. La raison principale résulte de tous les points ci-après et de la perception de l’absence de ce contrat moral cher aux entrepreneurs mentionné dans le témoignage de Renaud Dutreil : “Si je me plante, je me plante, si je réussi, je veux rentrer dans le club de ceux qui n’ont plus de problèmes d’argent et, si c’est possible, transmettre mon entreprise à mes enfants”. Pour autant, si le plantage vous tue économiquement parce que vous êtes caution solidaire personnelle de l’entreprise, si les marges sont faibles, si la réussite est villipendée et si l’ISF empêchera la succession… alors ceux qui ont le choix feront autre chose de leur vie. C’est justement ce qu’il convient d’inverser.
Les dix causes additionnelles
À la lecture de tous les rémoigngages, je choisis de retenir dix idées phares :
1/ La transmission empêchée par l’ISF avant le Pacte Dutreil. Les belles entreprises industrielles sont souvent des histoires familiales mises en danger lorsque les générations se renouvellent. On assiste là à une tension entre les intérêts bien compris du système social : faut-il ou non taxer les héritiers ? D’un côté, la taxe systématique de l’héritage est un mécanisme social sain et primordial. Il permet une redistribution des richesses et il évite que qu’une famille ne soit riche de génération en génération ad vitam aeternam. Une société sans impôt sur les successions virerait à la guerre civile après quelques générations : Ceux qui s’y trouvent économiquent pauvres se rendraient compte de l’impossibilité de faire évoluer le système et réagiraient violemment. Pour autant, cette logique appliquée aux entreprises industrielles familiales se révèle délétère. Il est difficile et long de construire des entreprises industielles. Il suffit d’une succession manquée pour les briser. Elles tombent ou sont vendues à un fonds financier qui les fera péricliter – non sans avoir au passage gagné de l’argent. L’ISF, en ne permettant pas aux héritiers de reprendre, a donc fait beaucoup de mal. Le pacte Dutreuil a permis une solution. Problème résolu au moins selon la plupart des témoignages.
2/ Les syndicalistes dans l’opposition systématique. La manière qu’ont les syndicats – et notamment la CGT – de jouer leur rôle est trop souvent mentionnée pour être ignorée dans le cadre de la déindustrialisation. Il ne s’agit pas de remettre en cause le droit à se syndiquer, les améliorations obtenues depuis deux siècles ou même le rôle de contre-poids à la direction. Il s’agit bien de la manière de jouer ce rôle. Au travers des profils recrutés pour devenir représentants du personnels, au travers de discours souvent extrêmes, au travers d’oppositions systématiques à tout ou presque, au travers d’actions parfois violentes physiquement… au travers de centaines de micro-événements, les syndicats sont parvenus à donner une mauvaise image de la France à l’étranger et à effrayer le corps dirigeant des industries. Dès lors, les usines françaises ont pris la tête des listes des lieux à fermer. Et fermer est devenu plus simple que de chercher un moyen de continuer. À titre plus personnel et anecdotique, ne plus avoir à subir les discours propagandistes semi-allumés (et je pèse mes mots) des délégués du personnel fit partie des grands soulagements de mon père lorsqu’il a vendu l’entreprise familiale. Il ne l’a pas vendue à cause de cela, mais ce point se trouvait très haut dans la liste ; beaucoup trop haut.
3/ L’administration contre les patrons. De nombreuses instances administratives disposent de beaucoup de pouvoir sur les entreprises avec souvent la capacité pour des individus isolés d’en user de manière discrétionnaire. Dès lors, un chef d’entreprise peut se trouver aux prises avec quelqu’un qui interprète les textes à sa manière ou fait du zèle et dipose d’un pouvoir de nuisance fort. L’inspection du travail et la direction de l’environnement (Dreal) reviennent fréquemment dans les textes. Dès lors, la question se pose : l’État se trouve-t-il dans le camp des entreprises dans le but de trouver des solutions communes qui favorisent le bien commun ? Ou les représentants de l’État mènent-ils une croisade anti-business de répression des richesses à la limite de la vengeance personnelle ? La question mérite d’autant plus d’être posée qu’il suffit parfois d’un ou deux individus de ce type pour pourrir le quotidien d’un dirigeant d’entreprises qui a d’autres problèmes à gérer par ailleurs. En novembre 2025, l’administration américaine se permet dans le document très controversé de National Security Strategy un rappel à son administration : “Every U.S. Government official that interacts with these countries should understand that part of their job is to help American companies compete and succeed.” On aurait envie de déclarations similaires à l’échelle nationale auprès d’une série d’instances qui, si elles peuvent se targuer de faire leur travail, le font peut-être top bien ou trop individuellement ou alors dans un style de communication trop agressif. Bien des patrons se plaignent qu’on les menace individuellement de peines au pénal un peu trop souvent. À un moment, cela use. Personne n’a envie de risquer la prison ; surtout si jeter l’éponge est une option.
4/ L’envie lancinante de jeter l’éponge. De nombreux responsables d’entreprises racontent l’usure au quotidien de leur vie de patron. Ils sont responsables pénalement de bien des problèmes éventuels : sécurité au travail, environnement, respect du droi social, etc. Une erreur quelque part peut amener des conséquences terribles à titre individuel. Et de nombreuses administrations peuvent bloquer leurs décsions ou l’usine. Un inspecteur du travail, un juge des prud’hommes ou un inspecteur environnemental local zélé peut faire tourner leur vie au cauchemar. De plus, ils sont vus en permanence comme le méchant de l’histoire. Tout cumulé, plus d’un raconte sa lassitude et son envie d’une autre vie. À titre anecdotique encore, mon père n’a pas été fâché de vendre de la frabique familiale. Il a beaucoup mieux vécu et dormi après le jour de la vente. Il n’a jamais été aussi heureux qu’après avoir quitté son costume de patron d’usine et n’a jamais regretté son choix. Tant mieux pour lui individuellement, mais collectivement, c’est un gâchis.
5/ Un environnement factuellement plus agréable hors de France. Nicolas Dufourcq résume bien dans son introduction un point de synthèse remonté par de nombreuses voies industrielles : “Les dirigeants de toutes tailles découvrent le plaisir d’être industriels ailleurs, dans des pays probusiness comme l’Europe de l’Est où les ouvriers, contremaîtres, ingénieurs des méthodes sont de très bonne qualité, dans un environnement de travail non conflictuel et flexible, avec le sutien de gouvernements porteurs d’un projet social global favorable à l’industrie.” Les quatre points précédents se sont donc trouvés empirés par un effet de comparaison qui a rendu d’autres pays plus attactifs. Les entreprises mondialisées et les talents qui ont eu le choix ont exercé leur possibilité de choisir.
6/ La robotisation bloquée par les taxes sur l’équipement. On touche ici un point subtil, central et complexe. Au fond, la désindustrialisation de la France est le résultat de milliers de microdécisions rationelles mises bout à bout. C’est-à-dire que cela s’est fait parce que c’était le choix le plus intelligent pour les personnes qui prenaient les décisions dans le jeu de contraintes qui étaient les leurs. Pour réindustrialiser la France, il faut donc surtout changer les règles du jeu afin que les entrepreurs choisissent – toujours de manière logique et raisonnée – l’option la plus positive collectivement. Revenons à notre sujet : plusieurs voix de l’ouvrage observent que l’industrie française compte peu de robots et de machines avancées par rapport à bien d’autres pays. Ils observent aussi que l’industie peut faire rêver si elle est tecnnologique et véhicule une image futuriste. Enfin, ils affirment que le coût du travail en France peut devenir un sujet mineur si l’usine compte en fait peu d’employés et beaucoup de machines. Ainsi, on pourrait imaginer un univers alternatif où la France ne se serait pas désindustrialisée, mais robotisée. Si ce n’est pas arrivé, c’est que le point de focus de tous est sur l’emploi. On a donc cherché à alléger le coût du travail, mais en contrepartie on a fait peser un ensemble de taxes – par exemple je crois la taxe d’apprentissage – sur le prix des équipements. Et en faisant cela, on a découragé l’investissement dans de meilleures machines. Il s’agit ici d’un sujet technique difficile à cerner sans entrer dans le détail et réaliser l’analyse. Le point est que l’assiette des taxes a des conséquences significatives sur les décisions prises. Ici, il pourrait être intéressant de modifier ce qu’il faut dans les règles fiscales pour relancer la robotisation. [Note : j’ai tenté de m’intéresser au sujet par ailleurs, notamment en lisant le baromètre européen des impôts de production 2025 de l’Institut Montaigne. Je n’ai pas réussi à comprendre le sujet tant les spécialistes présentent mal leur propos et omettent les règles fondamentales de bienséance et de communication qui consistent à bien vouloir expliquer de quoi ils discourent : définir les termes et rendrent leur sujet intelligible. Dommage !]
7/ Le manque de filières locales dues à la vision parisienne d’une économie monde. La Vendée et la vallée d’Arve semblent être parvenues à protéger des approches locales de filières où les entreprises proches travaillent ensemble. Lorsqu’on lit Breakneck de Dan Wang, c’est ce qu’il décrit pour Shenzen : un pôle de milliers d’entreprises les unes à côté des autres qui permettent de réaliser presque n’importe quoi très vite puisque toutes les compétences se trouvent proches les unes des autres et que tout le monde se connait. Il semble que dans bien des régions en dehors de ces deux exceptions, une conception mondialisée des chaines de production a conduit à des choix individuels qui ont détricoté progressivement les filières industrielles. La fonction Achat est souvent désignée comme responsable du mouvement. Bien des participants au livre de Nicolas Dufourcq mettent les centrales d’achat de la grande distribution en cause ainsi que l’opportunisme des acheteurs des grands groupes qui vont systématiquement au mieux offrant sur le prix, parfois à l’encontre de l’avis de leurs ingénieurs maison. À titre anecdotique, j’ai acheté en 2025 un grand nombre de produits aux couleurs de l’Europe à la boutique officielle du parlement européen. Tous les produits étaient fabriqués en Chine, y compris des sweats et T-shirts aux couleurs du drapeau européen pour lesquels il est évident qu’il existe des producteurs en Italie et au Portugal qui pourraient les réaliser à des prix à peu près compétitifs. Quand même le parlement européen fait fabriquer les T-shirts aux couleurs de son drapeau en Chine… “Something is rotten in the state of Denmark” comme dirait l’autre. Notons cependant que les acheteurs eux-mêmes n’ont souvent fait qu’exécuter les odres, suivi la mode de l’époque pour les délocalisations et les prix bas et cherché à faire baisser les coûts de fabrication pour assurer la compétitivité de leur employeur. Cependant, en comparaisoin avec l’Allemagne et l’Italie, pays plus régionalisés, il peut avoir manqué un ancrage régional chevillé au corp, justement ce que l’on trouve en Vendée et dans la vallée d’Arve.
8/ Une vision naïve ou arrongante du partage des tâches mondiales. Plusieurs voix semblent affirmer que l’on a véritablement cru que l’Europe pouvait délocaliser seulement les tâches à basse valeur ajoutée et conserver longtemps les centres de recherche, de design et donc de décision. Comme si le personnel des pays émergents – moins onéreux – devait pour des siècles et des siècles rester dans des positions subalternes et s’interdire de monter en gamme. Certains professionnels s’admettent même surpris de la vitesse à laquelle ces pays – par exemple la Chine – ont ratrapé leur retard. D’autant plus que l’on a souvent formé ces acteurs étrangers aujourd’hui cométiteurs quand on ne leur a pas vendu nos machines. Imaginer que la roue ne tourne pas, que l’étranger est moins intelligent, que les positions sont figées et surtout que l’on peut longtemps tenir le rôle du donneur d’ordre quand on est coupé du centre de fabrication tient pour le moins de la courte vue. Si ce n’est d’une arrogance coupable. Je comprends très bien les décisions individuelles qui ont mené à ces décisions. J’ose espérer que personne n’était véritablement dupe.
9/ La formation technique vécue comme une sous-éducation. De nombreux observateurs notent la faiblesse de la filière de l’éducation technique, par exemple par rapport à l’Allemagne qui compte de nombreux apprentis et où les études technologiques revêtent une certaine noblesse. Ils notent le très bas niveau des bacs professionnels et la volonté de faire en sorte que tout le monde ou presque obtienne un baccalauréat comme pernicieux. Ces bacs pros – et aussi technos – sont perçus à tort ou à raison comme des sous-formations. Et cela crée un climat délétère par rapport à reconnaître de diverses formes d’intelligence et d’excellence. Et comme de surcroît l’usine est considérée comme le dernier recours professionnel de celles et ceux qui n’ont pas le choix, il apparait que l’industrie française a manqué de talents dans les ateliers. Pas au niveau ingénieur, plutôt au niveau du dessous Un des patrons du livre l’écrit : “le travail de sape de l’éducation nationale a été dur à vivre”. Mais ne doit-il pas s’en prendre surtout à lui-même ?
10/ La faible communication des patrons français. Plus d’un témoignage de dirigeant reconnait qu’ils ont peut-être manqué d’investissement dans la défense des intérêts collectifs de l’industrie. Pour un ensemble de raisons dues au nombre de voix (on compte par définition moins de patrons que d’ouvriers syndiqués), au temps disponible (un patron a une usine à faire tourner) et à la complexité du message (expliquer l’économie représente une tâche plus ardue que d’asséner des slogans simplistes), les dirigeants ont perdu la bataille de la communication et se sont rendus inaudibles. Sans compter que les académiques, fonctionnaires et politiques n’aident pas toujours. Parmi les 49 témoignagnes du livre, certains me semblent fantasques ou surprenants pour dire le moins, et ceux que jugent si durement ne sont jamais signés d’un chef d’entreprises. Eux voient la période avec le prisme qui fut le leur. On peut être en accord ou en désaccord, mais il est difficile de leur nier le droit d’avoir ressenti la réalité ainsi. Dans le cas des témoignages qui signés d’autres fonctions représentées, certains semblent parfois évoluer sur une autre planète. À les lire, on se prend l’envie de ne placer que des anciens chefs d’entreprise dans les rôles de l’État qui s’en occupent. On pourrait accepter que les académiques, les fonctionnaires et les politiques les conseillent ; mais j’aurais envie que la responsabilité de la décision et la communication reviennent à celles et ceux qui peuvent se targuer de posséer une certaine expériece du terrain.
Passer aux solutions
Ce que le livre ne Nicolas Dufourcq ne contient pas, ce sont des propositions d’action. Ce n’est pas l’objectif de l’ouvrage. Pour mémoire et pour mes archives personnelles, je continue cette réflexion sur ce très intéressant ouvrage avec une liste de propositions d’actions directement liées aux points mentionnés précédemment. J’essaie d’être aussi précis et actionable que possible.
- Dépénaliser le rôle des patrons d’usine et bien distinguer le patrimoine personnel de celui de la société. Je voudrais que nous fassions la chasse à toutes les clauses et règles qui menacent d’envoyer un patron devant une cour de justice pénale avec la menace de la prison. Je comprends bien pourquoi et comment on a pu penser que mettre en cause la responsabilité personnelle d’un dirigeant – par exemple dans le cadre de la sécurité au travail – serait une bonne idée. Pour autant, à force d’empiler les menaces, on vire au harcèlement, on mine l’enthousiasme et on enferme les individus dans des rôles. De même, pour peu que cela soit encore légal, je veux que personne ne vive ce que mon père a vécu : avoir la maison familiale caution de l’achat d’une machine-outil auprès de la banque. Bref, je veux que l’on rende au chef d’entreprise manufacturière une certaine liberté d’esprit pour décider, vivre et dormir la nuit. Stresser les individus est le meilleur moyen de mener à l’échec.
- Demander à l’administration de servir le business. L’inspection du travail, la Dreal, le département et toutes les instances de l’État doivent avoir pour but le développement de l’emploi et des usines sur leur territoire. Elles sont au service du développement économique du pays. Dans les ordres qu’on leur donne, dans les discours qu’elles tiennent et dans les objectifs qu’on leur attribue, j’ai envie que l’on rappelle sans cesse aux administrations qu’elles sont au service de l’économie et pas de leur échec. Elles doivent certes jouer leur rôle et il ne s’agit pas de leur demander clémence, laxisme ou complaisance. Il s’agit de jouer le rôle d’un auxiliaire économique, et pas d’un agent de destruction ou d’obstruction.
- Repenser la filière éducative technique avec son nom et sa noblesse. Renommer les baccalauréts professionnels et technologiques avec d’autres noms que “baccalauréat” pour qu’on ne le compare pas au baccalauréat général. Je veux qu’on lui donne un nom qui autorise un sentiment de fierté et d’appartenance pour faire l’apologie de l’intelligence du geste et de la fabrication. Si le mot ingénieur – particulièrement bien choisi – est déjà pris, on pourra réfléchir autour de “fabere” ou “facere” pour “fabriquer” ou “faire” ; ou encore autour du mot “matière”. Mais qu’importe le nom tant qu’il permet une différenciation pour que la filière ne se sente pas un sous-choix !
- Ancrer les usines dans leurs territoires. Elles doivent être en lien fort avec le maire de la ville. Elles doivent être supervisées par leur département. Elles doivent soutenir les équipes sportives locales et les associations du coin. Elles doivent se considérer fortement ancrées dans leur territoire. Elles doivent générer une fierté locale et se sentir elles-mêmes fières de leur zone voisine directe. Tout cela aura indirectement des répercussions bien réelles sur la volonté de l’administration à aider, sur la possibilité de recruter des talents, sur l’adéquation des formations régionales aux besoins des employeurs et sur la capacité des chefs d’entreprise à se faire entendre. Si des lois anti-corrutions empêchent l’usine de soutenir l’équipe de basket locale, que l’université du coin est géré par Paris et que les décisions de l’usine sont prises depuis Londres… pas étonnant qu’aucune logique de filière ne parvienne à surnager. Laissons les locaux vivre local !
- Robotiser et technologiser pour faire advenir l’usine du futur. L’avenir est probablement aux fabirques très avancées techniquement. Les réalités du marché de l’emploi, des coûts et des niveaux éducatifs font que je n’imagine pas que l’on puisse faire revenir en France des indudstries très intensives en main d’oeuvre peu payées. Sauf à maintenir des niveaux de taxes douanières qui couperaient court au commerce international tel que nous le connaissons. J’ai donc envie d’une industrie très robotisée et très performante. Pour cela, il faut des robots, des transferts de technologie et que les taxes ne pèsent pas sur l’outil de production, mais sur les bénéfices. Laissons les industriels gagner de l’argent et taxons les gains !
- Mener une campagne d’image pour l’industrie du futur. Il existe des secteurs et des sujets qui opèrent des campagnes de lobby auprès des scénaristes de films et de séries télévisés pour qu’ils évitent de propager par mégarde des stéréotypes. La phrase précédente est parfaitement véridique, je l’ai vu de première main et je connais des personnes qui font métier de cela. C’est probablement ce que les patrons d’usine ne font pas assez : se préoccuper de la représentation de leur univers dans l’inconscient collectif. Cela va des livres pour enfants aux séries télés en passant par les pubs à la télé, les romans à la mode, les images générées par IA e toutes les représentations anodines du sujet. Si le mot usine appelle l’image mentale de Charlie Chaplin dans les temps modernes plutôt qu’un univers ultra-technologique, peformant et passionnant… la bataille est déjà perdue.
- Laisser les industriels gagner de l’argent et taxer les bénéfices. C’est peut-être la solution aux débats sur sur les taxes de production, l’attrait du rôle de patron d’usine et bien d’autres sujets. Quand les entreprises gagnent de l’argent, on trouve des bénéfices à taxer et de la valeur à partager. Dans le cas contraire… tout se complique !
Je conclue cette chronique, toujours pour mes archives, avec mon expérience très personnelle du sujet. En lisant 49 décideurs de l’époque qui ont vécu la désindustrialisation de la France entre 1995 et 2015, j’ai voulu raconter mon histoire également. À mon échelle, j’ai fait partie des millions de décideurs industriels de l’époque. Dans mon cas, en décidant notamment de ne pas y aller ! 😉 J’ai pris cette décision de manière rationnel dans un contexte global qui est tout à fait en ligne avec l’ouvrage choral de Nicolas Dufourcq. J’ai fait des choix fondés sur une analyse de la situation tout à fait concordante avec le diagnostic collectif des auteurs du livre. Aussi, si véritablement on souhaite réindustrialiser la France, on pourrait s’amuser à prendre mon cas anecdotique et se demander : qu’aurait-il fallu pour que ce jeune homme prenne une décision différente ?
Mon expérience (non) industrielle
J’écris ces lignes pour faire écho à l’ouvrage choral de Nicolas Dufourcq sur la désindustrialisation de la France entre 1995 et 2015. Il y invite des décideurs de l’époque à raconter comment ils l’ont vécu.
En lisant les témoignagnes, j’ai pensé à mon histoire. Celle de mon père, de ma soeur et la mienne et de notre décision quant à l’entreprise familiale centenaire Borover. À notre façon, nous avons traversé cette même période et pris des décisions rationnelles tout à fait dans l’ère du temps. Je ne regrette pas ces décisions : elles furent les bonnes pour l’ensemble des acteurs de l’histoire. En refermant l’ouvrage, j’ai eu envie d’y participer en y ajoutant un témoignage. Le mien.
Jérémy Borot, 44 ans en 2025, a pris la décision en 2007 de ne pas reprendre l’entreprise industrielle verrière familiale Borover, 15 employés et 1,5M€ de chiffre d’affaires. Son père Marc, 53 ans à l’époque, a donc vendu la société à un confrère et conservé une activité artisanale spécialisée pour les tanneries jusqu’à l’âge officiel de sa retraite. Marc décrit cette vente comme une des meilleures décisions de sa vie.
Mon arrière grand-père, George Borot, a fondé les établissements Borot en 1907. Il s’agissait d’une verrerie située dans le onzième arrondissement de Paris. Mon grand-père, André Borot, a pris la suite et y a travaillé toute sa vie. Il n’y a aucunement été contraint, mais il avait vingt ans quand la seconde guerre mondiale a commencé et vingt cinq ans quand elle s’est achevée. Dans la France de l’après-guerre, verrier de père en fils n’était pas une mauvaise situation. La décision fut donc probablement facile à prendre.
Quant à mon père Marc, il ne s’est pas tout de suite naturellement destiné à reprendre la société à présent nommée Borover. Diplômé en électronique, il a travaillé plusieurs années pour les systèmes radar du Mirage 2000, l’avion de combat de Dassault Aviation. Là-bas, il a estimé qu’il heurterait vite un plafond de verre professionnel puisqu’il n’était pas diplômé d’une grande école d’ingénieur. Et il a estimé que ses compétences technologiques se trouveraient vite dépassées. L’électronique évoluait déjà très vite dans les années 1970. Il évalua ses options et l’aventure entreneuriale d’être son propre patron lui sembla plus attractive que les alternatives.
Marc prit donc la suite de son père André et modernisa l’entreprise. Il déménagea d’un petit atelier au fond d’une impasse du onzième arrondissement de Paris à un grand local dans la zone industrielle de Montreuil-sous-bois. Il investit dans de nouvelles machines souvent venues d’Italie : table de coupe, four de trempe, four de bombage, tours, centre d’émaillage, cabine de sérigraphie, etc. Avec des hauts et des bas, Borover a nourri ma famille pendant trente ans de plus et pendant toute ma jeunesse. J’ai toujours connu mon père chef d’entreprise. Il y arrivait vers 8h30 le matin et quittait le local vers 19h30 pour arriver à la maison à 19h55 précises presque tous les soirs. Jamais avant, rarement après.
Mon père a donc connu une vie professionnelle enviable, mais difficile. Il était le chef de l’entreprise. Il était son propre patron. Il a pris ses choix lui-même et fait progresser le chiffre d’affaires, le parc industriel et les technologies. Il y a pris du plaisir et il y a connu des succès. Pour autant, ce n’était pas une position de tout repos. Une miroiterie est un lieu bruyant et surtout dangereux. Le verre est un matériau qui coupe et peut tuer. Seul un employé à ma connaissance y a jamais eu un accident grave, mais cela est tout de même arrivé. Sur place, Marc savait tout faire et faisait tout : commercial, administratif, mécanicien, ouvrier, etc. Il pouvait compter à ses côtés sur une assistante, un chef d’atelier et parfois un second ou un commercial selon les années, mais dans une entreprise de quinze à vingt-cinq personnes selon les périodes, le patron reste difficilement dispensable. Il travaillait 55 heures par semaine et ne prenait que six semaines de vacances par an : quatre en août quand l’usine fermait, une à Noël et une encore pendant l’hiver, mais l’usine ne fermait pas cette semaine-là. Il se rendait fréquemment à l’entreprise le week-end pour vider un four de bombage de verre et en relancer un autre. Bomber du verre prend toute une nuit. Si le résultat comptable de la société était positif presque tous les ans, les marges bénéficiaires étaient faibles : de l’odre de quelques pourcents. Et les années de déficit étaient d’autant plus difficiles à vivre que la maison familiale était caution personnelle des dettes de la société. La réalité des entrepreneurs industriels de l’époque est qu’ils se trouvaient caution personnelle des emrunts contractés par l’entité morale de la société auprès des banques.
Un industriel peut donc vite et à raison se sentir prisonnier de son métier. On ne peut pas se lever un matin et décider de fermer une usine, même si elle vous appartient. Le passif social est trop élevé. Il faut continuer. Il est ainsi arrivé à mon père de se payer au SMIC – donc moins que ses ouvriers – des années entières pour maintenir les comptes dans le vert. Au cours des années, certains employés ont fait vivre des péripéties plus ou moins cocasses quand il s’est agi de problèmes sociaux et familiaux ou pas drôles du tout quand certains se sont mis en tête d’intenter des procès aux prud’hommes – qu’aucun n’a jamais gagné – ou de se syndiquer dans le but très clair de constituer une force de blocage.
Aussi, la vie professionnelle de mon père ne tirera de larmes à personne, mais elle ne faisait pas rêver non plus. Dès le début des années 2000, il était à peu près sûr que ni ma soeur ni moi de souhaitions reprendre l’entreprise. Factuellement, je manquais d’intérêt pour les travaux manuels. Mais il est aussi possible que j’avais inconsciemmet intégré le fait que reprendre ne constituait pas une “voie royale”, c’est-à-dire – par définition – une voie en comparaison de laquelle toutes les alternatives apparaissent inférieures.
Au milieu des années 2000, je finissais mes études à l’ESSEC et ma soeur – ma cadette de trois ans – commençait les siennes à l’ESCP. La mode était à l’international et Borover était résolument installée dans la zone d’activité de Montreuil-sous-bois. Par ailleurs, maintenir l’activité supposait des réinvestissements systématiques dans des machines toujours plus coûteuses qui demandaient toujours de se porter caution personnelle, une pratique que l’on pourra juger pas tout à fait honnête ou éthique de la part des banques, mais qui était ce qu’elle était. Et le marché potentiel se trouvait limité. Il était constitué par les petites séries industrielles dont Saint-Gobain ne voulait pas, mais que les acheteurs jugeaient trop petites pour valoir le coup de les faire réaliser en Chine ou en Pologne. Les très gros marchés étaient pris par Saint-Gobain et toute fabrication de plus de 5000 pièces partait vers des pays à bas coûts. Mais quand il fallait 100 pièces, 500 ou parfois 1000 ou 2000, Borover se trouvait compétitif. Une niche existait et existe toujours, mais le plafond de verre à une croissance exponeitelle était bel et bien-là. Enfin, mon père avait vu plus d’un de ses confrères passer la main à son fils et rester de fait à l’atelier. Il ne voulait pas devenir ce septuagénaire qui continue par habitude à se rendre à l’usine le matin parce que son fils quarantenaire y tient la boutique. Il espérait une seconde vie, et pas celle-là.
Ce sont toutes ces raisons qui nous ont poussé à vendre la société familiale à un confrère l’année de ses cent ans. À l’époque, j’avais déjà rejoint un cabinet de conseil international. J’avais mes bureaux sur les Champs-Elysées et je voyageais en Classe Affaires à travers le monde où je logeais dans les meilleurs hôtels. Malgré cela, je me souviens avoir pris le temps de considérer posément l’opportunité professionnelle. Nous avions notamment calculé le salaire complet de mon père pour bien définir à quelles conditions accepeter une vente. J’avais tout pris en compte : salaire, bénéfices, retraite complémentaire, voiture et divers avantages. Le résultat était supérieur à mon salaire d’entrée chez McKinsy, mais ne promettait pas d’évolution rapide. J’avais dépassé ce salaire avant trente ans. À trente-cinq ans, je gagnais le double. Là où mon grand-père et mon père avaient vu dans l’usine une opportunité supérieure à leurs autres options, la même analyse menée en 2007 plutôt qu’en 1977 ou en 1947 amenait cette fois à une conclusion différente.
Borover fut vendue à un confrère – Verre Industrie – qui garda les clients, les machines et le personnel qui accepta de le suivre. Mon père accompagna la transition avant de prendre de fait une belle pré-retraite dès 55 ans. Il n’a jamais regretté d’avoir vendu et vit beaucoup mieux depuis qu’il n’a plus à se rendre à l’usine le matin. Ce confrère a fait croître son activité, a continué à investir et continue d’exister. Il n’y a donc pas eu de destruction du tissu industriel, plutôt une consolidation naturelle d’entreprises. On ne peut à proprement parler de désindustrialisation. Il s’agit plutôt d’une décision personnelle de ne pas reprendre car les carrières ouvertes par le diplôme d’une grande école de commerce et les perspectives de formation et d’évolution ouvertes par un cabinet international de conseil se trouvaient supérieures à ce que pouvait offrir l’entreprises familiale.
Individuellement, tout le monde y a donc trouvé son compte. Y compris le fils du repreneur de Borover qui dirige toujours Verre Industrie, une PME de niche florissante.
En savoir plus sur Curatus read
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.